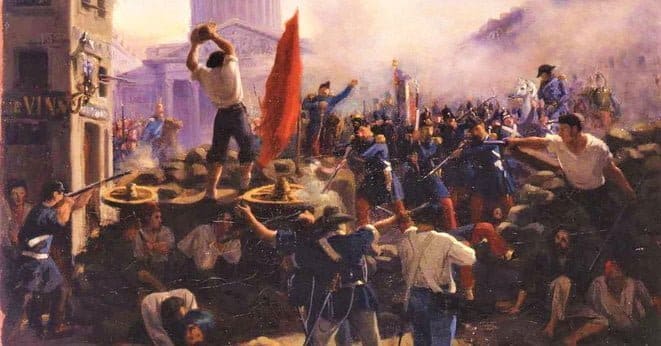Urbanisation
C’est aussi un siècle d’urbanisation. Il faut imaginer un pays où, en 1806, plus de 80% des gens vivaient à la campagne. En 1910, ils ne seront plus que 50%. Entretemps, les villes changent de visage et grossissent démesurément. En 1800, Paris intra-muros compte 550 000 habitants ; à la veille de première guerre mondiale, près de trois millions (bien plus qu’aujourd’hui !). Tout en grandissant, les villes se transforment : les sons, les odeurs, les couleurs changent. A la fin du siècle, l’électricité illumine l’espace urbain dans les grandes capitales. La ville apparaît aussi comme le lieu où tout est possible, où tous les espoirs sont permis (Le Rouge et le Noir) par contraste avec la campagne où rien ne se passe, où rien n’arrive (Madame Bovary).